Carine-Laure Desguin : "une affaire peut en cacher une autre..."

Une affaire peut en cacher une autre…
Avec une queue de renard qui pendouillait sur un long manteau en astrakan, un sac griffé de je-ne –sais-quelle-marque-requine et des chaussures en écailles de peau de croco, la mémé qui se pointait ce matin-là devant moi ne représentait ni le quinze août ni la société de protection des petites bêtes…Déjà que mon horoscope, en ce début d’année, ne prévoyait rien de bien joli pour le poisson ascendant lion que j’étais…
Mon cerveau a commencé à flotter car la brave dame puait la bourgeoisie malsaine, celle qui s’est assise sur la sueur de pauvres gens et qui engouffre maintenant les mains dans l’eau des bénitiers, histoire de rendre plus propre toutes les tuyauteries d’une fausse bonne conscience.
Ses traits remplis d’un fond de teint épais dissimulaient très mal un caractère tordu. Je sais de quoi je parle. J’en ai vu défiler sur cette chaise, des nanas qui m’allongeaient une liasse de billets pour que je passe des soirées à filer leur cher époux…Et, une fois mon enquête entamée, je m’apercevais naïvement que l’époux en question était l’amant de la dame…
Mais la perverse assise devant moi cachait encore quelque chose de plus abject. Dès la première minute, j’ai sniffé du gros calibre…
- Asseyez-vous, je vous en prie, lui dis-je avec mon p’tit côté moqueur… Vous avez un air surpris…Oui, je sais, toute cette paperasserie étalée sur mon bureau…ça effraie les gens bien ordonnés…A moins que ce ne soit la couleur de mes cheveux qui éclairent vos yeux d’une telle perplexité ? continuai-je en bon français…
- Non, ce n’est pas ça, me répond-elle sans hésiter, en me fixant si droit dans les orbites que pour un peu je me serais sentie éclaboussée par toute cette peinture qui maquillait ses vieilles paupières.
Je secouai la tête en haussant les épaules, ce qui voulait dire que vraiment, je ne comprenais pas ce qui la rendait tellement étonnée. En vérité, je le savais. C’est pareil à chaque fois …Déjà que mes cheveux rouge brique jamais trop bien coiffés et le butterfly sur le dos de ma main droite provoquaient de la suffocation chez les honnêtes gens …
- C’est que, voyez-vous, madame…ou mademoiselle, je ne sais pas au juste…Je pensais en lisant le nom inscrit à côté de la fonction détective privé, là sur la plaque à côté du numéro de votre immeuble que…
- Que Sam Paternoster, c’était un type d’une bonne quarantaine d’année, avec un trench couleur taupe et un abdomen épais, genre Robert Mitchum alias Philip Marlowe dans Adieu ma jolie…
- Oui, lâcha-t-elle, en se tortillant d’un air énervé en accrochant par mégarde une de ses breloques en diam à la boucle dorée de son sac…
- Et bien désolée mais Sam, c’est le diminutif de Samantha, tout simplement m’dame ! rétorquai-je en m’empressant d’allumer une clope, tout ça pour me donner une contenance devant ce gros sac de nœuds.
Ses yeux globuleux balayaient d’un regard suspect tout l’intérieur de ma cage. Je la suspectais de ne pas aimer l’art urbain : c’est vrai que les tags de toutes les couleurs lancés sur les murs de mon appart par mon pote Tom en ont déjà déboussolé plus d’un…
- Madame Dutilleul, puis-je vous demander ce qui vous amène à recourir au travail d’un détective privé …Ou avez-vous changé d’avis, peut-être ? lui demandai-je sur le ton pressé de celle qui n’a pas que ça à faire car d’autres clients attendent ses services.
En silence, la bourgeoise évalua rapido la situation, en cherchant dans mes petits gestes saccadés et mon regard de braise …la réponse à ma question.
- Et bien, dit-elle d’une voix toute radoucie, presque mielleuse, il s’agit de mon grand garçon, Edouard Dutilleul…
- Il lui est arrivé quelque chose ? continuai-je sur le même ton …
- Oui et non…C’est que justement, je ne voudrais pas qu’il lui arrivasse des soucis…de nos jours savez-vous …
- Venons-en aux faits, madame Dutilleul, lui dis-je en jetant un œil sur les derniers mails qui venaient de se pointer sur le pc…
- Je soupçonne Edouard d’avoir une liaison et …
- Il est marié ? lui demandai-je en lui coupant la parole…exprès car je savais que les femmes de son genre détestent être interrompues !
- Edouard, marié ! Vous n’y pensez pas ! Aucune femme ne rentrera chez moi sans mon consentement! Vous entendez, aucune ! C’est moi et personne d’autre qui choisirai la mère de mes futurs petits-enfants ! Ils seront les héritiers d’un patrimoine lourd de plusieurs dizaines de millions ! Je veux évaluer moi-même la prochaine madame Dutilleul !
Je n’en croyais ni mes yeux ni mes oreilles ! On aurait dit que tout d’une fois une mygale venait de piquer le cul de cette bourgeoise prétentieuse ; excusez-moi du pléonasme…
Après avoir soufflé quelques volutes dans les airs, pour décompresser un peu, je pris un raccourci car des situations pareilles, je les comptais par dizaines.
- Et donc, je parie que vous soupçonnez Edouard Dutilleul de sortir avec une nana …Et tout ça sans le dire à sa maaaaaman, n’est-ce pas ?
- C’est ça, soupira-t-elle, toute soulagée…en s’empressant d’ajouter que mon prix serait le sien et qu’elle savait me verser les arrhes requis ….
La vieille semblait connaître la musique…Je n’étais sans doute pas son premier détective privé…C’est sûr qu’à chaque fois que le petit Edouard rentrait plus tard ou ne rentrait pas du tout, sa maaaman engageait un quidam pour une filature resserrée.
- Voici des photos de mon Edouard…Regardez, quelle prestance il a dans son Armani ! gémit-elle, ce qui se traduisait par et dire que le pauvre petit se fait bouffer tout cru par une salope que je ne connais pas …Et ceci est une liste des endroits qu’il fréquente…Je vous suggère Le Métropole, place de Brouckère …Le siège administratif de notre société est à deux pas de là, boulevard Anspach et d’ailleurs je…
- Bien, bien, lui dis-je pour la rassurer, tout en prenant bien soin de lui couper la parole une seconde fois, juste pour éprouver son système nerveux au tout grand maximum.
Le lendemain, vers midi, bien campée sur la terrasse chauffée du Métropole – nous étions le 15 janvier quand même -, je simulais de glander…Les grooms s’affairaient à accueillir une délégation d’hommes politiques africains, c’était marrant à voir ; un peu comme si l’esclavage s’était trompé de côté ! Mes cheveux rouge brique tout ébouriffés et mon butterfly sur le dos de ma main droite attiraient l’attention des clients huppés de cet hôtel chic de la capitale…Pas discret me dira-t-on pour un privé mais je ne troquerais pour rien au monde mon look punkie contre un deux pièces à la noix qui me donnerait une allure guindée, aux antipodes de ce que je suis.
Je commençais à siroter un whisky coca quand un gars aux allures de dandy, engoncé dans un costume Armani, frôla mon bras droit…
Edouaaaaard Dutilleul ! Je ne pouvais pas me tromper ! Un beau grand type aux lèvres encore pleines de lait maternel ! C’était bien lui ! Seul…
J’attendis quelques minutes et puis, direction water closet…En passant dans la grande salle, que vis-je, juste en- dessous de ces magnifiques ornements art déco, là, dans un coin pas très bien éclairé ?
Edouaaard Dutilleul….bien accolé à un p’tit gars bien propre sur lui, vernis sur les ongles et rimmel sur les cils ! Pour un peu j’oubliais de me rendre aux water closet ! Question petits-enfants de l’empire Dutilleul, c’était mal barré…
Quelques minutes plus tard, j’étais de nouveau sur la terrasse et là, clic clac clic clac, en me tortillant comme un ver de terre, je réussis à prendre quelques photos de nos mignons tourtereaux…Ces deux –là semblaient ne pas s’ennuyer …
- Dites-moi, ne serait-ce pas ce slameur bien connu… dont j’ai oublié le nom, assis là, à côté du beau garçon au costume Armani, tout au fond de la salle ?
- Oh non répond le garçon bien amusé ! Monsieur Dutilleul est avec son ami, Etienne Belliard, le styliste de la rue Antoine Dansaert !
Voilà comment on tire les vers du nez d’un pauvre garçon de salle …
Et bien, quand madaaaame Dutilleul aura le bec sur ces photos…Son petit garçon caressant la main d’un styliste, ça va grincer …
Brave cœur comme je suis, je convoquai dès le lendemain notre merde- poule…
Je jubilais en imaginant la tronche de cette vieille rombière….Et bien là, grave erreur, c’est moi qui fut étonnée…Ses gros doigts asphyxiés par des bagues aux pierres rutilantes prirent les photos froidement. Pas la moindre sueur n’a perlé. Aucun état d’âme. Rien !
La Dutilleul me regarda d’un air de dire j’aurais encore mieux aimé que mon fils se tape une fille comme vous…
Elle allongea une liasse de billets, prit les photos et s’éclipsa comme un courant d’air, comme si une foule de choses à exécuter l’attendaient…Du jamais vu !
Cette nana ne m’inspirait rien de bon. Dès le départ, j’avais sniffé du malsain qui transpirait de ses pores. Mais rien de bien précis, ce jour-là, ne se rappela à ma mémoire.
Mon pressentiment se confirma quelques jours plus tard ….
Dans le journal, mes yeux s’arrêtèrent net sur cet article :
« Le styliste très prometteur de la rue Antoine Dansaert, Etienne Belliard, ne nous fera plus rêver…Le corps poignardé du jeune créateur fut retrouvé hier, dans son atelier de couture, baignant dans une mare de sang … »
Dutilleul, Dutilleul…ce nom me revînt à la mémoire …De l’hémoglobine, un homo….Oui, oui ! Bordel de bordel ! Une affaire vieille de cinq ans, à l’époque, je potassais toutes les affaires criminelles de la capitale…Mais oui, bien sûr !
Un coiffeur de la rue Neuve, retrouvé mort lui aussi …On n’a jamais retrouvé le criminel mais le nom d’Edouard Dutilleul avait été cité dans la presse…
Ce jour-là, je venais de boucler deux affaires à la fois !
Grâce à la perspicacité – excusez-moi du peu - de Sam Paternoster, une jeune privée aux cheveux rouge brique et à l’allure punkie, madame Dutilleul, reine mère d’un empire léger comme un château de cartes, eut tout le temps nécessaire pour astiquer toutes ses breloques, seule, dans une geôle de la capitale…
Carine-Laure Desguin
http://carinelauredesguin.over-blog.com
/http%3A%2F%2Fwww.bandbsa.be%2Fcontes3%2Fenfantsjardinr.jpg)



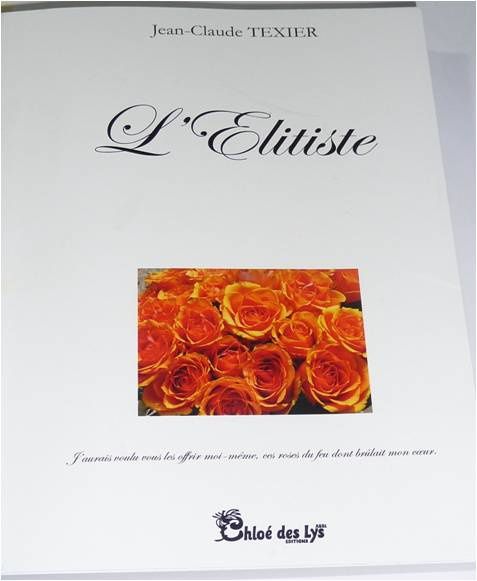

/http%3A%2F%2Fwww.bandbsa.be%2Fcontes2%2Fnouvellepeaurecto.jpg)




/http%3A%2F%2Fwww.bandbsa.be%2Fcontes2%2Fekelsontete.jpg)
/http%3A%2F%2Fwww.bandbsa.be%2Fcontes2%2Faimermurirrv.jpg)
/http%3A%2F%2Fwww.bandbsa.be%2Fcontes2%2Findipresentrecto.jpg)
/http%3A%2F%2Fwww.bandbsa.be%2Fcontes2%2Ftoilevertrecto.jpg)

