/http%3A%2F%2Fwww.bandbsa.be%2Fcontes%2Fgerard.jpg)
Émile Vacher, âgé de trente-trois ans seulement, est l’un des pires tueurs en série de l’histoire. C’est à la sortie des grandes villes et des villages qu’Émile a abordé la plupart de ses proies. Ce vaste carrefour est ouvert à tous les vents, encadré de barres de béton, ou d’arbres touffus, comme il en existe tant à la périphérie des cités et des bourgs. Sa première victime est un petit garçon de dix ans retrouvé sous des branches d’arbres. Les victimes étaient majoritairement de sexe féminin, soit de jeunes adolescents et adolescentes, soit des femmes ayant environ soixante-dix ans. Les meurtres de femmes âgées furent sans doute des accidents dus au mauvais caractère d’Émile Vacher, et pourtant, il les viola.
Toutefois, les préférences sexuelles de Vacher allaient aux garçons de treize à seize ans, qui ont tous subi des sévices sexuels. Il agissait presque toujours de la même manière. Il saisissait ses victimes par le cou, il commençait à les étrangler, puis il les égorgeait et, souvent, les éventrait. Ensuite, il mutilait leurs parties sexuelles. Souvent, il les violait après son crime. La majorité des assassinats a été commis entre le mois de mai et la première quinzaine d’octobre. On peut penser à des périodes de « crise » meurtrières.
Lorsqu’il rencontre Joseph Lamiau, l’enfant joue près du parc, c’est un jeudi, le 15 mai. Il s’approche et lui propose de jouer avec lui. Le petit acquiesce. Vacher sort de sa poche un couteau et le menace. Les yeux paniqués, Joseph se remet debout et suit l’homme sous la contrainte. Arrivé dans la forêt, le sinistre individu attrape le gamin par le cou et commence à l’étrangler. Le petit Lamiau s’évanouit et tombe au sol. Vacher, d’un geste rapide, lui coupe la gorge. Du sang gicle sur lui. Il sourit, observe sa victime qui tremble, et s’étouffe dans son sang. Il la déshabille, plonge ses mains vers son sexe et le coupe brutalement.
Ses mains ensanglantées se débarrassent du petit pénis qui les encombre et atterrit dans les fourrés. Il retourne l’enfant sur le ventre et le viole sauvagement.
Vacher, à genoux, contemple le corps. Il respire fort, par à-coups, il se sent soulagé tout d’un coup. Pendant un instant, il se sent bien, il n’en veut plus à la terre entière.
Il se remet debout, coupe des branches, et les jette sur le corps de sa jeune victime. Puis il reprend sa route sans se retourner.
***
Tyler est en vacances. Après avoir résolu l’affaire de l’abattoir de Surgères, il a pris quelques jours de repos, dans l’ile de Ré. Il loge dans un gîte, rue Marie Galante dans la maison que lui prête le Dr Pereira, le légiste du commissariat.
Au commissariat, Gino le coéquipier de Tyler, un sandwich débordant de mayonnaise à la main, lit une fiche interne, qui l’informe qu’un enfant de dix ans vient d’être trouvé étranglé dans le bois Henry IV dans l’ile de Ré, sur la commune de la Couarde. Il a été retrouvé nu, il a subi des violences sexuelles. Il a été émasculé, et il a des coupures sur le ventre. Le corps se trouve à la morgue de La Rochelle.
- Il faut que je prévienne Tyler, se dit-il.
Il prend son téléphone et appelle son supérieur.
- Allo ! chef, c’est Gino. Les vacances se passent-elles bien ?
- Quand tu m’appelles pendant mes vacances, il y a un problème, lui répond Tyler.
- Oui, écoute-moi Tyler ! J’ai deux choses à te dire, la première c’est que le directeur veut te voir, la seconde chose, c’est qu’on a un meurtre sur les bras.
- Tu m’expliques pour ce meurtre ?
- Laisse tomber, je t’expliquerai quand tu seras là. Le directeur veut te voir, et je pense que c’est urgent !
Tyler se met à réfléchir rapidement.
- Bon, dis-lui que j’arrive ! Mais, tu me parles de ce meurtre ?
- Gino ? Tu m’expliques pour le meurtre ? Enfin !
Gino se tait un instant. Il faut que je lui dise, sinon il me fera la tête pendant dix jours, pense-t-il.
- Ben ! Un promeneur a trouvé un corps sous des branches, le corps d’un enfant de dix ans environ, il a subi des violences sexuelles, et il a été étranglé, il est mort depuis au moins trois jours.
- Tu appelles les gendarmes ? Tu leur demandes des renseignements complémentaires sur l’affaire, tu me donnes tout cela quand j’arrive, mais ce ne sera que demain. Avant, j’ai une visite à faire. Pour le directeur, tu ne lui dis rien.
- Ah ! J’allais oublier, tu vas voir le Dr Pereira. Si le corps est à la morgue, il aura peut-être d’autres renseignements complémentaires.
- Arrête de manger ! Tu vas encore mettre de la mayonnaise partout.
- Gino, surpris, pose son sandwich sur le bureau.
- Mais comment tu sais que je mange ? demande-t-il ?
- J’entends tes mâchoires, je ne suis pas sourd.
- Tu fais ce que je demande, moi, j’ai un rendez-vous !
Tyler raccroche son téléphone, sort de sa maison de vacances, monte dans sa vieille DS et se dirige vers son rendez-vous, à Saint Martin de Ré. Pendant le trajet, il repense au meurtre du petit garçon. Qui a bien pu faire ça s’interroge-t-il ? En plus, pendant mes vacances, et dans l’ile de Ré. Arrivant à Saint Martin, il gare sa voiture sans fermer ses portes, comme de coutume, et se dirige vers le café du centre.
Il jette un œil à l’intérieur du bar pour voir si Anaïs est déjà là. Il l’aperçoit sur la terrasse en train de déguster un café, comme à son habitude. Sans se faire voir, il la regarde avec des yeux admiratifs, pleins d’amour.
- Elle est toujours aussi belle juge-t-il en s’approchant,
- Bonjour, lui dit-il en l’embrassant sur la bouche.
- Tu vas bien ce matin ?
Souriante, elle lui rend son baiser. Le sien a un gout de café ; il aime cela. Il s’assoit en face d’elle et commande un café : ce baiser lui a donné envie. Il a renoué avec Anaïs après son enquête sur les meurtres de l’abattoir de Surgères. Elle n’attendait que cela, elle désirait qu’il revienne. Maintenant, elle ne le lâche plus, elle compte bien finir ses jours avec lui, même si son métier ne lui facilite pas la vie.
Il lui prend la main, un peu gêné.
– Tu sais, Gino m’a appelé pour m’informer qu’un meurtre a été commis dans l’ile. Il faut que j’aille à La Rochelle ce matin pour voir mon patron. Il va surement me confier l’enquête, mais, en attendant, on va aller faire un tour sur la plage.
Anaïs est médecin à l’hôpital de Bordeaux, elle s’occupe de la réanimation des grands blessés de la route. Elle a toujours eu des sentiments pour Tyler, elle l’aime, c’est l’amour de sa vie. Elle est heureuse de passer quelques jours avec lui, même si elle ne le voit pas tous les jours. Les enquêtes de police sont un des éléments qui ont fait qu’elle se soit éloignée pendant quelque temps, mais Tyler lui manquait trop, alors elle est revenue.
Sur la plage, main dans la main, les pieds dans l’eau, ils se promènent en discutant de leur avenir, mais Tyler est préoccupé par cette nouvelle mission. Il est distrait, il n’écoute pas vraiment les propos d’Anaïs.
- Tu n’écoutes pas, souffle-t-elle.
Tyler ne répond pas, plongé dans ses pensées.
- Tyler, Tyler, tu es où ?
-
Pardon, j’étais ailleurs ! Il faut que je parte, mon patron m’attend !
Elle sourit, prend sa tête dans ses mains et pose un baiser sur sa bouche.
–Allez, va résoudre cette affaire. Je vais aller voir mes parents, tu m’appelles dès que tu as un moment.
Il la regarde s’éloigner de la plage, entrer dans sa vieille voiture, et se diriger vers La Rochelle. Il s’assoit dans le sable un instant, cette affaire de meurtre lui occupe l’esprit. Le pauvre gamin, quand même, je l’aurai ce type, je l’aurai, se jure-t-il.
Il monte dans sa DS et prend la direction de La Rochelle lui aussi.
Gérard Loiseau
Gérard Loiseau
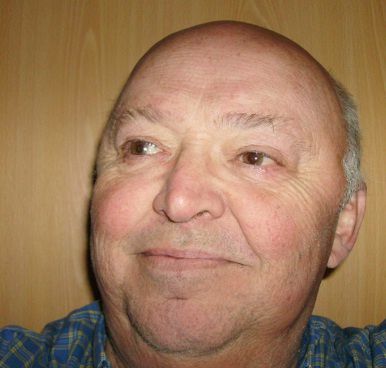


 vole notre raison d’être, lorsqu’elle bafoue le ciment de notre existence, tout en laissant des amarres qui nous empêchent de fuir, des responsabilités que personne ne peut prendre à notre place, seule la sauvegarde de l’illusion peut nous maintenir à flots…
vole notre raison d’être, lorsqu’elle bafoue le ciment de notre existence, tout en laissant des amarres qui nous empêchent de fuir, des responsabilités que personne ne peut prendre à notre place, seule la sauvegarde de l’illusion peut nous maintenir à flots…/http%3A%2F%2Fwww.bandbsa.be%2Fcontes%2Fvuillemin.jpg)

/http%3A%2F%2Fwww.bandbsa.be%2Fcontes2%2Fetoilemagiquerecto.jpg)


/http%3A%2F%2Fwww.bandbsa.be%2Fcontes%2Fgerard.jpg)
/http%3A%2F%2Fwww.waltermacchi.com%2Ftemplates%2Fja_mona%2Fimages%2Fclassic_interface%2Fsymbol.png)
 jeune femme avait disparu une demi-heure auparavant. Tout là-haut, les lumières de son appartement étaient à présent éteintes. Il attendit encore une dizaine de minutes et se dit qu'il était temps d'y aller. Il ne pouvait rester indéfiniment assis derrière son volant, le quartier était branché et les patrouilles de police régulières. Ce n'était pas le moment de se faire repérer. Tout avait parfaitement fonctionné jusqu'ici. Subtiliser les clefs et en faire un double avait été un jeu d'enfant. Il prit son téléphone portable et envoya le message qu'il avait composé un peu plus tôt dans l'après-midi. Il saisit la mallette en cuir à ses côtés, entra à son tour dans l'immeuble et monta au sixième. Comme le matin même, il s'introduisit dans l'appartement et fit une halte dans le vestibule, ses sens aux aguets. Tout était calme et silencieux. Il enfila une paire de chaussons en plastique pour éviter de laisser des traces de pas sur l'épaisse moquette beige, se repéra dans l'obscurité aidé par les lumières de la ville et s'avança avec précaution jusqu'à la chambre à coucher. La jeune femme était profondément endormie. Comme prévu, elle avait avalé les comprimés. Il ouvrit la valisette, en sortit un flacon transparent, remplit une seringue du liquide incolore qu'il contenait et souleva la couette. Sans prêter la moindre attention au corps magnifique de la jeune femme, il lui injecta le contenu de la seringue dans le bras. Elle avait fait des analyses sanguines en début de matinée et même un médecin trop curieux n'y verrait que du feu. Il échangea le flacon de vitamines avec un flacon similaire, le reposa sur la table de nuit, prit trois tubes de somnifères et leur emballage et les répandit sur le lit. Il sortit ensuite du bar du salon une bouteille de whisky et revint dans la chambre. Il remplit d’un peu d’alcool le verre d'eau que la jeune femme avait utilisé peu avant et fit rouler le tout sous le pied du lit. La respiration de sa victime était de plus en plus faible. Il inspecta une dernière fois les lieux pour vérifier qu'il n'avait rien oublié et partit comme il était venu.
jeune femme avait disparu une demi-heure auparavant. Tout là-haut, les lumières de son appartement étaient à présent éteintes. Il attendit encore une dizaine de minutes et se dit qu'il était temps d'y aller. Il ne pouvait rester indéfiniment assis derrière son volant, le quartier était branché et les patrouilles de police régulières. Ce n'était pas le moment de se faire repérer. Tout avait parfaitement fonctionné jusqu'ici. Subtiliser les clefs et en faire un double avait été un jeu d'enfant. Il prit son téléphone portable et envoya le message qu'il avait composé un peu plus tôt dans l'après-midi. Il saisit la mallette en cuir à ses côtés, entra à son tour dans l'immeuble et monta au sixième. Comme le matin même, il s'introduisit dans l'appartement et fit une halte dans le vestibule, ses sens aux aguets. Tout était calme et silencieux. Il enfila une paire de chaussons en plastique pour éviter de laisser des traces de pas sur l'épaisse moquette beige, se repéra dans l'obscurité aidé par les lumières de la ville et s'avança avec précaution jusqu'à la chambre à coucher. La jeune femme était profondément endormie. Comme prévu, elle avait avalé les comprimés. Il ouvrit la valisette, en sortit un flacon transparent, remplit une seringue du liquide incolore qu'il contenait et souleva la couette. Sans prêter la moindre attention au corps magnifique de la jeune femme, il lui injecta le contenu de la seringue dans le bras. Elle avait fait des analyses sanguines en début de matinée et même un médecin trop curieux n'y verrait que du feu. Il échangea le flacon de vitamines avec un flacon similaire, le reposa sur la table de nuit, prit trois tubes de somnifères et leur emballage et les répandit sur le lit. Il sortit ensuite du bar du salon une bouteille de whisky et revint dans la chambre. Il remplit d’un peu d’alcool le verre d'eau que la jeune femme avait utilisé peu avant et fit rouler le tout sous le pied du lit. La respiration de sa victime était de plus en plus faible. Il inspecta une dernière fois les lieux pour vérifier qu'il n'avait rien oublié et partit comme il était venu.
 connaissait des tas pour y avoir passé des journées entières à penser, à faire des croquis, ou tout simplement à bavarder avec des amis. Maintenant, elle sortait de chez elle comme elle sortait de sa prison mentale, et pour éviter de ressasser les visions chaotiques qui la poursuivaient, elle essayait de se concentrer sur le paysage en le commentant haut et fort pour tenter de renouer ce lien presque mystique qu’elle avait construit avec « ses ruelles ». C’est tout juste si elle remarquait les gens qui se retournaient sur son passage en la prenant pour une folle. Cinq minutes de concentration et de commentaire à voix haute ne parvenaient pas à éradiquer les questions. L’envoûtement que le Paris du XXème arrondissement avait opéré sur elle avec son atmosphère qu’on ne retrouve nulle part ailleurs, faite du mélange de quartiers populaires et d’une jeunesse étudiante plus bohème que la jeunesse branchée du XIème, ne parvenait plus à fournir son cadre aux aspirations infinies : à la place, une morne poésie déplaçait le pas sans déplacer le temps. Á nouveau, elle pressa le bouton du petit magnétophone planqué dans la poche avant de sa veste :
connaissait des tas pour y avoir passé des journées entières à penser, à faire des croquis, ou tout simplement à bavarder avec des amis. Maintenant, elle sortait de chez elle comme elle sortait de sa prison mentale, et pour éviter de ressasser les visions chaotiques qui la poursuivaient, elle essayait de se concentrer sur le paysage en le commentant haut et fort pour tenter de renouer ce lien presque mystique qu’elle avait construit avec « ses ruelles ». C’est tout juste si elle remarquait les gens qui se retournaient sur son passage en la prenant pour une folle. Cinq minutes de concentration et de commentaire à voix haute ne parvenaient pas à éradiquer les questions. L’envoûtement que le Paris du XXème arrondissement avait opéré sur elle avec son atmosphère qu’on ne retrouve nulle part ailleurs, faite du mélange de quartiers populaires et d’une jeunesse étudiante plus bohème que la jeunesse branchée du XIème, ne parvenait plus à fournir son cadre aux aspirations infinies : à la place, une morne poésie déplaçait le pas sans déplacer le temps. Á nouveau, elle pressa le bouton du petit magnétophone planqué dans la poche avant de sa veste : Le bruit de ses pas résonnait dans la ville au même rythme que les battements de son cœur.
Le bruit de ses pas résonnait dans la ville au même rythme que les battements de son cœur. elle – Isadora profitait de la fête de la Lune rousse dédiée à la Déesse Mella pour se balader dans les rues presque désertes. Le ciel était d’un bleu éclatant et le soleil, pour une fois cette saison, ne jouait pas sa vierge effarouchée. Le curieux duo venait d’emprunter une allée boisée que surplombaient de magnifiques demeures. La dernière, légèrement en retrait par rapport aux autres, était surmontée d’une gigantesque serre dont chaque carreau réfléchissait les rayons de l’astre. Elle ne manquait jamais de détailler les sculptures qui l’entouraient quand ses promenades la conduisaient à proximité.
elle – Isadora profitait de la fête de la Lune rousse dédiée à la Déesse Mella pour se balader dans les rues presque désertes. Le ciel était d’un bleu éclatant et le soleil, pour une fois cette saison, ne jouait pas sa vierge effarouchée. Le curieux duo venait d’emprunter une allée boisée que surplombaient de magnifiques demeures. La dernière, légèrement en retrait par rapport aux autres, était surmontée d’une gigantesque serre dont chaque carreau réfléchissait les rayons de l’astre. Elle ne manquait jamais de détailler les sculptures qui l’entouraient quand ses promenades la conduisaient à proximité.