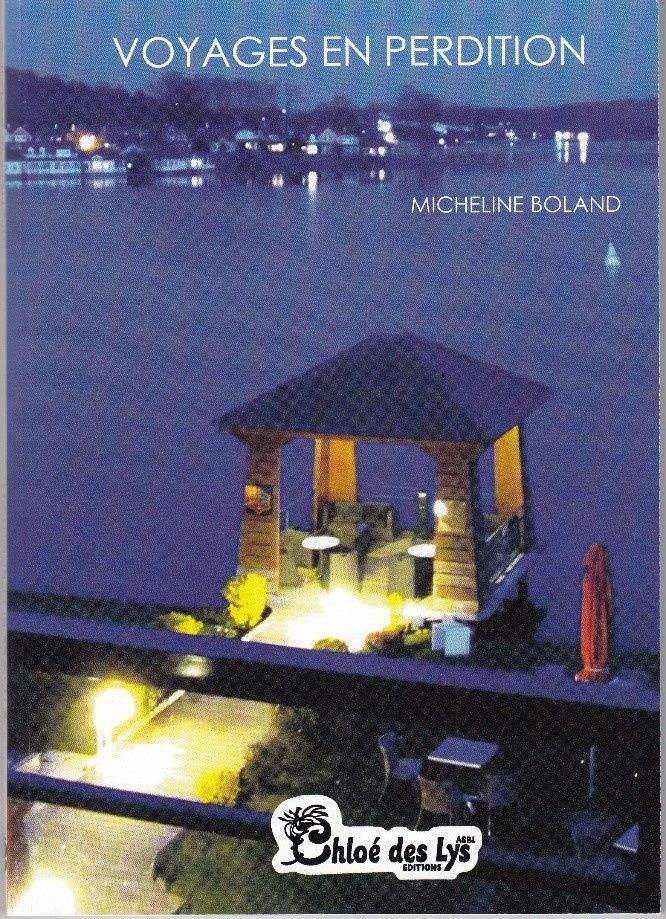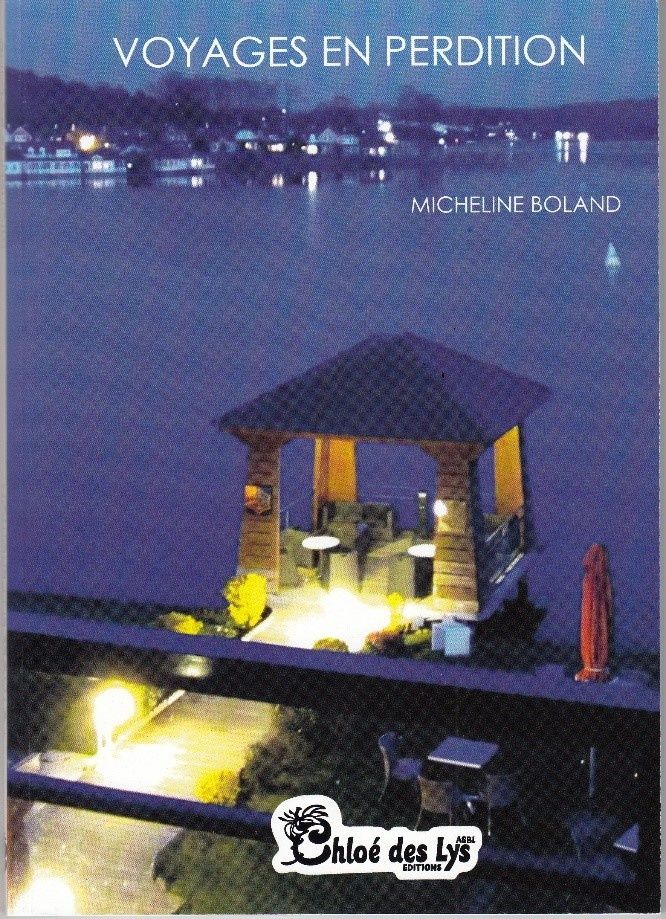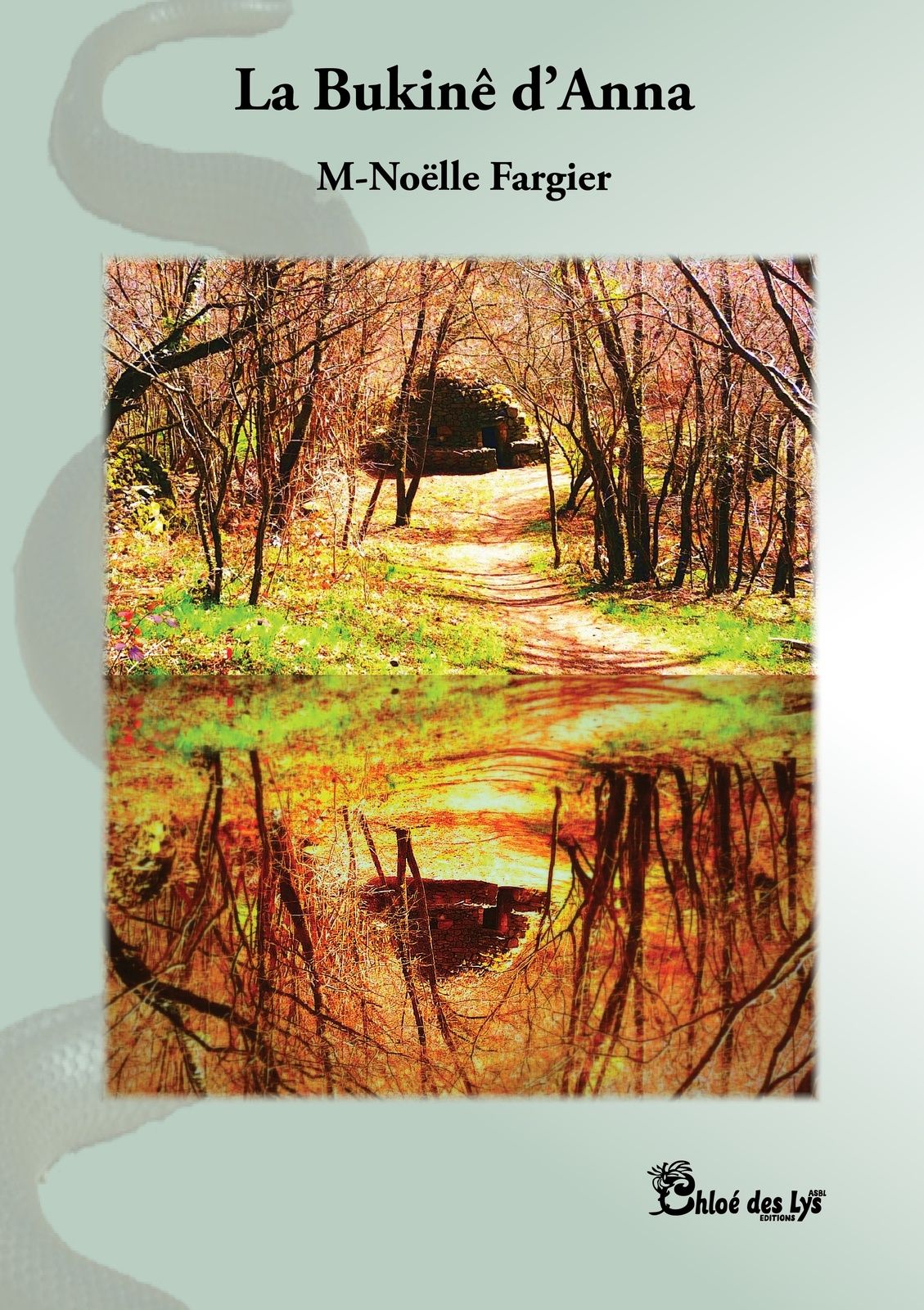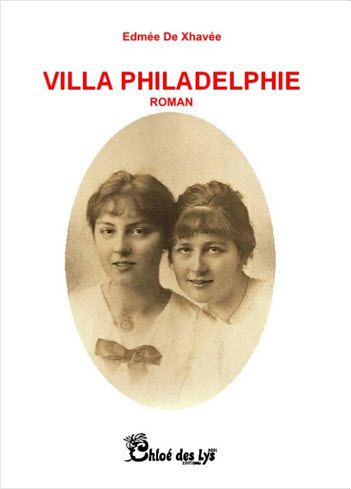Edméé de Xhavée nous propose une nouvelle "Les funérailles de la baldracca"

Les funérailles de la baldracca – Edmée De Xhavée
Une baldracca, en italien, c’est une « pute »…
La brume se détache, comme à contrecœur, des contreforts rocheux et de la cime des arbres crispés sous le froid de l’automne. Le son de la cloche de Santa Maria dei Tanti Peccati vibre dans l’air dense et humide de cette journée rousse de feuilles et grise de ciel. Sur le chemin qui monte à l’église, on entend tousser et renifler les vieux, geindre un enfant, admonester une mère impatiente dont le timbre de la voix trahit une joie qu’il ne faut pas gâcher par des enfantillages. Pas aujourd’hui, alors qu’enfin la baldracca, la putain, le déshonneur du village, celle dont le visage hideux servait de Befana (sorcière) pour garder les enfants sages sera mise sous terre.
Sous terre, où elle devrait être depuis une vie, cette vie qui a duré trop longtemps, pense Aldo, le veuf qui ne mime même pas le chagrin, et a promis à tous une tournée de grappa Pinot Barricata, une grappa d’exception, pas comme celle qu’ils distillent eux-mêmes ici dans la montagne et dans laquelle ils enfoncent une vipère à la mâchoire déployée… Plutôt que d’oublier dans l’alcool, il compte bien célébrer sa vie ainsi nettoyée par la main de Dieu de la honte qui a sali la renommée des siens… Son sacrifice interminable… Dieu a enfin eu pitié de ses efforts…
Il était temps, dit sur un ton à peine discret la Pina à sa sœur, bras dessus-bras dessous quelques mètres derrière Aldo. Il est encore bel homme, droit, et sa veste noire, dont elle a recousu les parements, lui donne une classe que ses habits de tous les jours ne permettent pas de déceler. Une petite année de deuil par décence, et elle pourra entrer chez lui en mariée, en maîtresse des lieux, et effacer toute trace du passage de la baldracca. Sa sœur soulève les épaules, sourit et chuchote à la Pina, avec un coup de coude discret dans le creux de la taille « c’est enfin ton tour d’être heureuse, oui ! Après presque vingt ans, tu y a bien droit…»
Derrière Aldo, les trois enfants qu’il a eus de la baldracca. L’aînée, Léopoldina a les yeux de sa mère, de ce bleu éperdu de ciel printanier, mais le teint et les cheveux d’Aldo, bistre et noirs, brisés en boucles laineuses et indomptables. Ses traits sont remarquablement beaux, et le temps apportant un oubli cruel parfois, on en est venu à se demander comment, avec une mère aussi affreuse, une telle chose était permise par la nature.
Insouciante, elle parle avec sa plus jeune sœur, Laura, qui lorgne à la dérobée le jeune Filiberto, dont les parents gèrent le seul restaurant de la région, restaurant qui attire des touristes pendant toute la belle saison pour manger leur fameux ragù di capriolo ai funghi, le ragout de chevreuil aux champignons. Elle le sait, Filiberto comme elle vit cette journée comme un cadeau d’espoir, car l’idée d’avoir la baldracca comme belle-mère était impensable, et sa mort vient de les libérer d’une frustration amoureuse qui se faisait très lourde. Le pas plus lent que ses deux sœurs, Beppe, lui aussi paré des yeux maternels mais également de son teint clair, de ses cheveux lisses couleur thé, et de lèvres qu’Aldo et sa grand-mère lui ont toujours conseillé de « tenir tranquilles ». Fais-les donc tenir tranquilles, ces indécences. Car les filles du village, elles, dissimulent les leurs quand elles le voient, tandis qu’elles relaient avidement le secret qu’elles trahissent, ces deux parts d’une bouche trop belle et gourmande… Car elles rappellent, leur ont dit leurs mères, celles du beau Nando. Nando qui est un jour parti pour ne pas revenir, donnant un tel chagrin à son père qu’il s’est jeté depuis le point de vue vers la vallée au bord de la route en lacets. Beppe, comme ses sœurs, sent que ce jour est un jour d’envol, que la brume se lèvera et le soleil, enfin, baignera leurs vies à tous.
Appuyée contre sa fille Alma, la vieille Rosa serre ce qui lui reste de dents. Bon vent la baldracca, bon vent et qu’on puisse t’oublier. Car ce que tu as fait à mon fils, le plus beau des fils, ce Nando sorti de mon ventre comme un oiseau de paradis qui serait né dans un poulailler, je ne peux te le pardonner. Pas plus que le saut de son père que le chagrin avait ailé, et qui m’a laissée veuve avec une fille que personne n’épousera plus, son temps est passé et son corps s’est tari. Tu aurais pu mourir avant ton heure, tu aurais pu hâter le destin, et nous laisser une chance de descendance…
Trop faible pour marcher, assise dans une chaise roulante poussée par son mari Ernesto, Inès, la mère d’Aldo, le chapelet entre les doigts déformés par l’arthrose et la méchanceté, le menton piqué de poils noirs levé dans une expression altière et triomphante. Ernesto, enfin, enfin… je pense que c’est le plus beau jour de ma vie, le plus beau dans l’absolu. Nous avons été de bons chrétiens, avons supporté l’épreuve que le Seigneur avait dans ses plans pour nous, mais de sa mort nous ne sommes pas responsables, et enfin la récompense est venue. C’est le plus beau jour de ma vie, je te dis ! A ses côtés, sa fille Gianna la pecora comme on l’appelle, Gianna la brebis, ses gros yeux tristes remplis de croûtes, et ses pensées ricanant amèrement dans le secret de son cœur.
Le père de la baldracca, Remo le taiseux, veuf depuis l’abominable histoire, le père d’une baldracca qui avait coiffé de honte tout un village. Sa femme n’avait survécu que trois semaines au drame, et son fils le Massimo était resté en ville où il étudiait, pour ne jamais revenir, se limitant à quelques cartes postales ici et là. Le vieil Anselmo, lui rendant visite un jour, avait rapporté au village que sur son bureau trônait une photo agrandie de sa baldracca de sœur, avec un petit vase rempli de fleurs séchées devant. Mais même pour les funérailles de sa sœur il n’est pas revenu… Par la faute de cette fille éhontée il avait tout perdu, attaché à ce village qui détenait toutes ses racines et ses repaires, l’en rendant prisonnier.
Un jour sans doute oublierait-on même que la baldracca avait vraiment existé.
Dans le cercueil de planches, le moins cher, le plus sordidement bon marché, portée par six gars du village désignés pour la tâche et le visage plus furieux qu’attristé, la baldracca repose enfin en paix. Pour elle aussi c’est le jour de la grande renaissance, et de sa récompense. Un par un elle renverse en tête, comme des quilles malfaisantes, les habitants et les faits de ce village et de sa vie.
Aldo d’abord fier et avide de sa pâle beauté d’elfe translucide, comme il l’appelait, et puis haineux, jaloux, blessé de sa propre rusticité… poussé par la Inès, laide et épousée pour ses terres, et la Gianna née sans menton et devant laquelle on faisait bêêê en riant, et dont on savait qu’elle resterait pucelle. Les coups, les insultes, les affirmations selon lesquelles elle se croyait mieux que sa mère et sa sœur, que lui-même.
Remo son père, qui de taiseux était devenu muet, ne lui avait plus jamais parlé. A peine un mouvement du menton s’il la croisait dans la rue, les dents serrées et le regard luisant comme la fureur qui sort d’un volcan.
Ses filles, Léopoldina et Laura, égoïstes et sans cœur, travaillées par la rancœur que leur avaient transmise la Inès, Ernesto, Aldo et les autres, et qu’elles n’avaient jamais remise en question. Convaincues que tout ce qui bloquait des joies infinies, c’était elle, qui pourtant continuait de coudre, cuisiner, réparer, nettoyer comme avant, pour qu’elles profitent de leur vie. La sienne, après tout… qu’elle s’use en vase clos n’était pas plus mal, elle était si effrayante à regarder maintenant… Seuls ses yeux parlaient encore d’un vertige infini.
La Pina, ah la Pina… oh elle le lui aurait bien donné, son Aldo, elle le voulait tellement. Voulait-elle les coups aussi, les humiliations, les crachats dans les cheveux ou les coups de pieds aux fesses après l’amour qu’il faisait comme un possédé qui expurge sa haine ? Elle n’avait encore eu, la Pina, que l’amour à petites doses, celui qui ressemble à des dragées délicieuses, et les caresses sur les doigts, sur les seins, et les mots les plus tendres qu’il avait dans son répertoire. Et surtout, elle avait l’illusion qu’une fois la baldracca hors du chemin, ce serait place à la romance et les petits soins. Là dans son cercueil plein d’échardes, ce qui reste d’elle rayonne un court instant, à l’idée des surprises âpres comme la rue fétide qui attendent la Pina une fois le temps de deuil épuisé dans l’impatience…
Beppe, son fils, son amour de fils, celui qui ressemble à Nando et la hait pour cette raison… et comme elle le comprend. C’est lui qui résume tout le drame, l’endosse comme un manteau poisseux.
La Rosa et l’Alma, jalouses de la beauté surnaturelle de ce fils et frère qui avait traversé le sang de leur famille, et dont on ne trouvait plus de trace sinon dans Beppe… Jalouses de ce garçon que, elles se tuaient à le rappeler, elle leur avait ravi avec ses jeux de paupières et les reflets de sa peau pâle. Le scandale avait été si sonore qu’il était, leur avait-on dit, parti en courant dans la vallée pour ne jamais en reprendre le chemin, tandis que les larmes et cris du père l’avaient fait plonger dans le vide à sa poursuite.
Mais la baldracca sait où il est, Nando. Ses os, elle les a lavés chaque année, à l’anniversaire du drame. Elle descend le long du versant aux myrtilles et bolets, dans le silence mousseux du sous-bois, avec un seau et une éponge, et elle le lave doucement, lui parle, le touche, et lui demande de l’attendre, que ça ne saurait plus être long. Elle a fait ce rituel chaque année, après avoir, au début, protégé le corps des gros prédateurs en le recouvrant d’une grosse épaisseur de brindilles, branches et feuilles, le tout surmonté d’un panneau de bois où elle jetait un peu d’essence lors de ses promenades. Depuis longtemps maintenant il ne reste que les os et la veste de cuir, raide et moisie, ainsi que les chaussures. Et la splendeur de leur couple immortel.
Les faits sont encore clairs dans ce qui lui reste de conscience, même s’ils se diluent comme le fait cette brume matinale dont elle ne fait plus vraiment partie. Leur liaison découverte par Aldo qui, aidé de ses parents Ernesto et Inès, suivis du père de Nando que l’on trainait de force, les ont suivis puis surpris, étendus dans l’amour sous les ramures complices. Inès qui a vidé la fiole de vitriol sur le visage et la poitrine de sa belle-fille alors qu’Aldo émasculait Nando avec son couteau de chasse, pour enfoncer ses testicules, hurlant et pleurant, dans la bouche fondue de son épouse. Et enfin forçant le père à saigner son propre fils, dont elle avait tenu le regard mourant dans le sien jusqu’à la fin, rapide.
Le fils qui leur était né six mois plus tard, et qui n’eut la vie sauve que parce qu’il était un fils.
Nando, Nando… enfin, j’arrive !
Stefania, mon aimée… tu sais, chaque jour et chaque heure, je me suis glissé dans ton ombre… je ne t’ai jamais quittée…
EDMEE DE XHAVEE