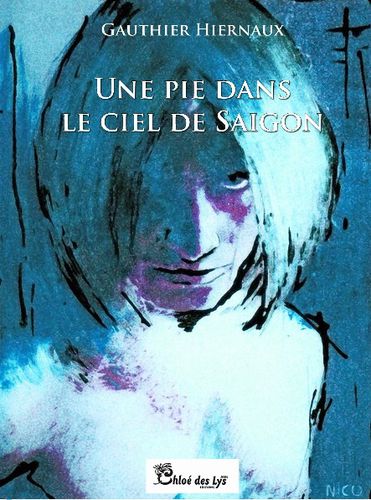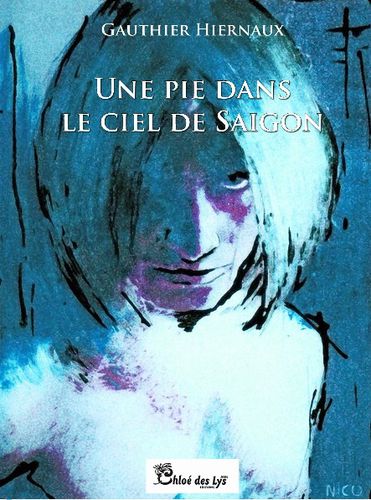
Ça avait commencé tout bêtement, par hasard. Le hasard… comme il haïssait ce mot ! Depuis, il se sentait comme un animal traqué par le Destin.
Il savait pourtant que c’était stupide, qu’il n’avait pas demandé ça et qu’on ne pourrait pas lui reprocher de s’être fait mousser pour le plaisir d’un peu de publicité. Il n’était pas comme le voisin de ses parents, qui aurait appelé la presse uniquement parce qu’il venait de s’acheter un tracteur pour tondre son gazon.
John-John, en l’honneur des Kennedy, Sizeman était un garçon timoré, à la limite de l’autisme. Sa vie était pourrie de petites manies de vieux garçon – qu’il était déjà à trente et un ans – du lever au coucher, chaque jour de la semaine, année après année. Jamais il ne dérogeait à ses habitudes.
Jusqu’à ce jour terrible où il avait fait un pas de travers. Le pas fatal, comme l’équilibriste qui avait décidé de tenter le grand saut. Cette erreur, il la regretterait encore longtemps.
John-John Sizeman allongea le pas en direction du parc et pria pour que son banc ne soit pas pris. Il avait besoin de s'asseoir et de réfléchir, sur SON banc et pas un autre. Il l'avait choisi dix ans auparavant quand il n'était encore qu'un simple étudiant en informatique. Il ne réussissait à prendre des décisions que les fesses posées sur ce bois peint. En avait-il essayé un autre ? À quoi bon si celui-ci avait toujours fait ses preuves.
Le garçon s'engagea du côté gauche de l'allée
(toujours remonter du côté gauche et redescendre du côté droit, c'était un dogme)
et avança, sans regarder devant lui. Aux autres de s'écarter après tout! John-John avait le poids pour lui.
Depuis ses quinze ans, il ne se nourrissait que de quelques aliments, tous triés sur le volet pour lui apporter de quoi survivre. Il savait que, où qu'il aille aux États-Unis, ces produits seraient là. Il pouvait les conserver pendant des années, à l'abri de leur enveloppe de métal, sans craindre la rupture de stock. Car si John-John venait à manquer de ces denrées que d'aucuns auraient nommé "malbouffe", il ne saurait pas sur quoi se rabattre quitte à... modifier le PLAN. Or, on ne pouvait, sous aucun prétexte en dévier. John-John Sizeman, moins que quiconque, n'en n'avait le droit.
Il atteignit enfin la fontaine
(il avait reconnu le dessin des pavés qui en délimitaient le périmètre)
et osa enfin un regard en direction du banc. Un couple d'adolescents s'y bécotait sans vergogne. Il leur lança son regard des ténèbres, pourtant, ces deux là étaient trop affairés pour prêter attention au petit gros à casquette qui prenait l’ombre sous le platane.
John-John devait réagir. Mais que faire dans une telle situation ? Il n’avait même pas sa place dédicacée pour réfléchir ! Il lui fallait prendre une décision, coûte que coûte.
Pris d’une soudaine rage, il fonça vers le couple enlacé et leur hurla dessus jusqu’à ce qu’ils prennent peur et s’égaient comme des moineaux suite à un coup de fusil.
Soulagé, le garçon s’écroula sur le banc pour songer à ce qu’il devait faire, à comment réparer sa bourde. Le PLAN pourrait être à jamais compromis s’il acceptait de son plein gré ce terrible coup du sort.
Tout s’était mal enchaîné. D’ordinaire, il s’arrêtait à cette librairie uniquement pour s’acheter un paquet de chewing gums à la chlorophylle
(encore quelque chose qui ne disparaitrait pas de sitôt !)
mais ce matin, poussé par quelque démon, le libraire l’avait tenté comme le Serpent l’avait fait pour Ève .
John-John n’était pas un joueur
(trop de probabilités, trop de possibilités de sortir du PLAN).
Il fuyait tous les hasards, quels qu’ils soient puisque la vie n’était qu’une suite d’événements programmés à l’avance. Mais cet homme, Mister Miller, qu’il connaissait depuis tant d’années – cet infâme salopard devrait-il dire – lui avait tendu un billet de loterie, de ceux que l’on gratte avec une pièce ou l’ongle du pouce. Prétextant un oubli d’un client précédent, il avait essayé de le lui refiler. John-John avait d’abord catégoriquement refusé, mais Mister Miller s’était montré persuasif.
Allons, John-John, ce client a payé ce billet. Je ne peux pas le remettre sur le présentoir ! Ce serait… du vol.
Mais pourquoi vous ne le lui rendez pas à ce monsieur ? avait bredouillé le jeune homme, en sueur.
Tout bonnement parce que je ne sais pas de qui il s’agit ! avait rétorqué l’autre, vaguement agacé. Quelqu’un m’a acheté hier avant la fermeture une bonne dizaine de billets, un journal et deux ou trois bricoles comme un paquet de cigarettes, du briquet et des allumettes. Il en a oublié un sur le comptoir ! La belle affaire ! Autant que quelqu’un en profite !
Pourquoi pas vous, Monsieur Miller ?
Le vieux libraire avait pris un air gêné et écarté les bras de son gilet de mauvais goût avant de bredouiller un truc totalement incompréhensible où il était question d’éthique. En gros, il ne pouvait pas garder le billet car, s’il gagnait une grosse somme, il ne pourrait tout bonnement pas la garder. Autant que le bénéficiaire soit un client aussi régulier que Mr. Sizeman.
Le gras garçon avait noté un drôle de sourire sur la face ravinée du libraire, mais il était tellement perdu dans ses atermoiements qu’il l’enregistra sans l’analyser. Cela avait été là sa première erreur. Il connaissait bien Mr Miller et l’appréciait beaucoup car, s’il avait compris comment fonctionnait le gamin, il ne lui avait jamais fait la moindre remarque, contrairement aux autres personnes, famille et « amis » de l’entourage de John-John. Sans doute est-ce la raison pour laquelle, alors que sa raison s’y opposait farouchement, la main de John-John Sizeman s’empara du billet.
Il était onze heures moins le quart et, il n’avait pas encore entamé son paquet de chewing gums.
***
Arnie Miller, libraire depuis l’invention de l’imprimerie, chaussa ses nouvelles lunettes ultralégères que sa femme l’avait convaincu d’acheter et se dit que, décidemment, elles ne lui allaient pas. Il avait abandonné une monture qu’il trimballait sur son nez depuis vingt ans et qui ne se seraient jamais démodées pour la simple et bonne raison qu’elles n’avaient jamais été à la mode. Il avait fixé un petit miroir sur le mur droit de son comptoir, invisible pour autrui, car Arnie avait la hantise de servir ses clients avec le nez sale. C’était une manie qui datait du début de sa carrière et qui le poursuivait encore, d’autant plus que les poils clairsemés de son nez étaient devenus une véritable forêt dense depuis que ceux de son crâne l’avaient déserté.
Toutes les heures, surtout pendant l’hiver et les périodes d’allergie, Arnie s’observait les fosses nasales quand il n’avait personne à servir.
Il était en pleine exploration quand la clochette de la porte d’entrée l’avertit que son intimité était momentanément terminée. Il fit semblant de remettre de l’ordre dans ses billets de loterie le temps que le nouveau venu se plante devant le comptoir. Il attendait généralement le « bonjour » de l’individu pour faire semblant de se sortir la tête du travail, celui-ci ne venant cependant pas, le libraire feignit de reporter tout à fait incidemment son attention vers le client.
Il y vit cette grosse limace de John-John Sizeman qui faisait tellement honte à ses parents. Arnie Miller en avait pitié – même si la première image qui venait à lui quand il le voyait était « gastéropode » – et faisait tout pour le traiter comme un habitué de son petit commerce. Depuis quatre ans, cinq peut-être, ce type venait lui acheter tous les jours un paquet de chewing gums à la chlorophylle qui devait soit vider en une journée, soit collectionner depuis l’enfance. Il n’entrait qu’une seule fois dans sa boutique, à neuf heures pile et jamais, au grand jamais, une seconde fois.
Pourtant, il avait devant les yeux en cet instant même un John-John Sizeman blême et tremblant qui lui tendait un billet de loterie un peu froissé, le même sans doute que celui qu’il lui avait donné de bon cœur tout à l’heure.
Je vous le rends, Mister Miller. Je n’en veux pas.
Arnie se gratta le lobe de l’oreille et essaya un sourire, un clin d’œil et un haussement d’épaules dans un même mouvement.
Quand il avait réussi à refourguer ce billet à cet ersatz d’être humain quelque heures auparavant, il avait été partagé entre deux sentiments contradictoires. Il s’était senti l’âme d’un boy scout et d’un tentateur. À la fois, il souhaitait aider ce garçon à sortir de sa spirale infernale et, en même temps, il s’était rendu compte que le moyen n’était sans doute pas le bon. Un électrochoc d’être humain adulte pour ranimer un mulot. Il en avait la preuve de visu.
Rebonjour, John-John, chantonna-t-il. Que puis-je faire pour toi ? À nouveau…
Il grimaça intérieurement. Ces deux mots étaient de trop.
Le jeune Sizeman secoua le morceau de papier qu’il tenait fermement entre ses doigts boudinés avant de le plaquer sur le comptoir, pile entre le lecteur de cartes et les boîtes d’Oreo.
Arnie Miller remarqua qu’il n’avait même pas été gratté.
Je vous demande de reprendre ce billet, Mister Miller. S’il vous plaît… j’en veux pas.
Le commerçant s’éclaircit la gorge avant de faire la moue.
Bien. Bien. Comme tu voudras. Je le donnerai à quelqu’un d’autre en ce cas…
Et avant qu’il ait pu ajouter le moindre mot, Sizeman avait jaillit de la boutique, laissant le vieux libraire comme deux ronds de flanc.
Il revenait à peine de sa surprise quand la cloche tintinnabula de nouveau et la porte s’ouvrit sur la silhouette légèrement voûtée, mais encore alerte, de Mr Alberts.
Elmore Alberts avait passé sa vie sur les routes. Représentant de commerce retraité, il n’aspirait désormais plus qu’à profiter de sa villa, durement gagnée par des années de sacrifices. De ce qu’Arnie en savait, il n’avait ni femme ni enfant et vivait seul malgré son âge.
Comme le fils Sizeman, il venait tous les jours à la boutique, à la seule différence près que ses achats variaient.
Ils se saluèrent aimablement, prenant des nouvelles de l’un et de l’autre, puis le vieillard réclama son journal et un paquet de pastilles à la menthe. Le libraire profita de sa présence pour tenter de se débarrasser du billet refusé par John-John Sizeman. Comme son prédécesseur, il montrait une certaine méfiance à l’égard d’un cadeau qu’il jugeait injustifié. Miller et lui-même n’étaient pas si proches pour qu’il lui fasse pareil présent. Le commerçant eut beau argumenter, le représentant retraité se montra inflexible et quitta la boutique un peu irrité.
Hé ben… merde alors ! souffla Arnie Miller de plus en plus dépité.
Il avait passé sa vie à vendre des tonnes de trucs (parfois inutiles) et c’était bien la première fois qu’on lui refusait un machin gratuit.
Il se mit à fourrager furieusement dans son nez jusqu’à ce que la clochette retentisse une troisième fois. C’était cet imbécile de facteur. S’il y avait bien un quidam à qui il n’avait aucune envie de filer un billet de loterie c’était bien lui !
Les clients se succédèrent et plus aucun ne trouva grâce à ses yeux. Le fils Sizeman et le vieux représentant l’avaient mis dans une humeur telle qu’il ne desserra pratiquement plus les lèvres de la journée.
***
Il était sept heures passées de cinq minutes quand Arnie Miller ouvra le volet métallique qui condamnait pour la nuit l’entrée de sa boutique.
Son caractère s’était à peine radouci car la nuit ne lui avait pas porté conseil. Sa double rebuffade lui avait véritablement porté sur les nerfs. Pourtant, alors qu’il ouvrait le rideau de fer de sa boutique, le libraire tentait de relativiser. Après tout, il s’était fait remettre à sa place par un vieux solitaire un peu grincheux et un gamin taré. Il n’avait pas à s’en faire. Il n’était pas mis en cause. D’ailleurs, pour quelle raison ces refus lui tenaient-ils tellement à cœur ?
Tu te retournes pas, OK ?
Arnie eut un hoquet de surprise. La voix assurée, quoique juvénile, avait éclaté à quelques centimètres de son oreille. Il ne voyait pas son agresseur, il ne sentait que l’odeur du cuir qui émanait de sa veste et son haleine de Red Bull.
Ne fais pas de conneries, p’tit ! Tu veux quoi ?
M’appelle pas « p’tit », vieux con !
Tu veux quoi ? La caisse ? Je commence ma journée, il n’y a rien dedans, tu sais. En tous cas, pas grand-chose…
Il y eut un long silence à l’arrière. Le gamin avait l’air de mesurer l’étendue de sa bêtise. Quant au libraire, il se demandait s’il n’avait pas donné un tuyau à ce garçon. Il devrait se montrer prudent ce soir. Peut-être devrait-il investir dans un spray de défense en plus de la barre à mine placée en-dessous du comptoir.
Il n’y avait pas un chat dans la rue. Il n’y avait jamais personne quand un vieux type ou une fille se faisait agresser. Ses collègues des autres boutiques avaient tous été au moins une fois braqués, mais le vieil Arnie se vantait la semaine dernière encore de ne pas encore avoir fait les frais de la petite criminalité. Sans doute sa boutique faisait-elle plus pitié qu’envie, un constat qui le rassurait, mais ne l’enchantait guère. Aujourd’hui, il pouvait se rassurer. Ce constat, amer, était loin de le porter aux nues.
L’odeur de Red Bull se fit plus forte quand le gamin approcha ses lèvres de l’oreille velue du commerçant. Il sentit la pointe d’une lame presser le bas de son dos.
Tu me files ton ‘larfeuille’ alors.
Arnie sentit des doigts s’introduire dans la poche de son pantalon de velours côtelé, puis en ressortir aussitôt pour se faufiler dans celle de son veston. Ils en ressortirent cette fois avec le butin. Il n’essaya pas de se défendre. Outre le fait que son agresseur avait la force et la jeunesse pour lui, il savait que son cuir élimé n’abritait qu’un peu de mitraille et quelques billets pour démarrer sa caisse. Il entendit le gamin farfouiller dans son bien et le bruit caractéristique des coupures qu’on fourre sans ménagement dans la poche d’un pantalon.
« Pourquoi t’as pas gratté ton billet ?
Hein ?
Le jeune type soupira et lui donna une petite bourrade dans le dos.
Ton billet à gratter, putain ! Tu le gardes sur toi parce que c’est joli ?
Le fameux billet doublement refusé oublié par le client d’hier matin. La veille, sans réfléchir, Arnie l’avait plié en deux et glissé dans son portefeuille fatigué. Il ne savait pas ce qui l’avait poussé à faire ça, mais il ne trouvait pas honnête de le remettre dans le présentoir avec ceux qui n’avaient pas encore trouvé acquéreur.
Il s’éclaircit la gorge avant de proposer :
Prends-le si tu veux.
Je veux, ouais, grogna le braqueur.
Le libraire laissa le gamin gratter la couche protectrice du billet, résigné.
BORDEL !
Le commerçant se retourna à demi.
Quoi ? Quoi ?
N’obtenant aucune réponse, il poursuivit sa rotation. Il se retrouva bientôt face à un adolescent – seize ans, peut-être – portant un blouson en cuir brun fermé jusqu’au cou, jeans troué aux genoux et casquette enfoncée jusqu’aux oreilles. Une moustache – de celles qu’on peine à laisser pousser entre les boutons d’acné – garnissait le dessus de sa lèvre supérieure. Le gamin louchait sur le billet qu’il tenait fermement à deux mains. Arnie remarqua que le cran d’arrêt gisait sur le sol. Le gamin ne paraissait pas s’en soucier.
Quoi ? redemanda le vieux monsieur en arrachant le billet des mains de son vis-à-vis. Qu’est-ce que tu v…
Il n’acheva pas sa question. Devant ses yeux écarquillés s’étalaient plus de zéros que le commerçant n’avait jamais vus de toute sa vie.
Holly shit !
Putain, ouais ! répliqua le petit loubard qui retira sa casquette pour s’éponger le front de sa manche.
Ils restèrent muets un instant avant de se regarder au même moment. Arnie vit dans les yeux du gamin une franche résolution qui l’effraya. Il n’avait pas le choix, il devait jouer le tout pour le tout.
Ecoute, fils, je sais à quoi tu penses. C’est de la folie et je vais t’expliquer pourquoi. Rentre un instant dans ma boutique s’il te plaît. Il fait froid ce matin…
Le jeune homme ne voulait pas. Revenant peu à peu de sa surprise, il redevenait crâne et demandait à son aîné ce qui l’empêchait de le poinçonner pour lui piquer le billet. La face ridée d’Arnie Miller s’émailla d’un sourire.
« Tu n’y connais pas grand-chose à la vie, hein ? Fils, tu peux faire valider ton billet uniquement dans la librairie où tu l’as acheté… ça limite la fraude, tu comprends ? Si tu me tranches la gorge comme tu prévois de le faire, ma boutique sera fermée en attendant un repreneur. Ça peut prendre des mois, des années peut-être. En attendant, la somme aura été remise en jeu.
Le petit caïd hochait la tête, convaincu. Il venait de ramasser et de ranger son couteau dans la poche de son manteau de cuir et suivait docilement le vieux type dans sa librairie. Miller n’arrêtait pas de pérorer, ravi que son mensonge prenne, lui qui n’avait jamais été filou dans l’âme.
« Voilà ce que je te propose, poursuivit-il en refermant le volet derrière eux, je valide ton billet et on partage les gains. Bien sûr, tu es obligé de me faire confiance, mais je pense que je suis dans le même cas…
Il s’approcha du comptoir et le contourna pour se retrouver de l’autre côté, près du tiroir-caisse encore vide dans lequel il faillit y déverser la mitraille et les coupures contenues dans son portefeuille. Il prit un air d’excuse et tendit la main en direction du garçon.
« Pourrais-tu me rendre l’argent, fils ? J’aimerais mon fond de caisse pour ouvrir la boutique.
Heu… ouais, ouais, fit le jeune homme en retirant de sa poche revolver l’objet de son larcin.
Allez, viens ! Approche, je ne vais pas te manger, ricana le vieil Arnie tandis que sa main agrippait sous le comptoir la barre à mine.
Gauthier HIERNAUX
grandeuretdecadence.wordpress.com
/image%2F0995560%2F20151205%2Fob_c4f970_fondpoussette.jpg)

/image%2F0995560%2F20151205%2Fob_6f4661_grandperecover.jpg)
/image%2F0995560%2F20151205%2Fob_ace12b_annonciade.jpg)
/image%2F0995560%2F20151205%2Fob_8efbcd_maisondieu.jpg)
/image%2F0995560%2F20151205%2Fob_0df450_point-d-interrogation.gif)
/image%2F0995560%2F20150907%2Fob_e49a2e_carine-laure-desguin.jpg)
/image%2F0995560%2F20150907%2Fob_0d002d_barakarecto.jpg)
/image%2F0995560%2F20150907%2Fob_8447a9_enfantsjardinr.jpg)
/image%2F0995560%2F20150907%2Fob_79bd90_spiralesurbaines.jpg)
/image%2F0995560%2F20150907%2Fob_968047_pointinterro.jpg)
/image%2F0995560%2F20150117%2Fob_b0b6d9_carine-laure-desguin.jpg)
/image%2F0995560%2F20150117%2Fob_5b28ce_barakarecto.jpg)
/image%2F0995560%2F20150117%2Fob_335d95_enfantsjardinr.jpg)
/image%2F0995560%2F20150117%2Fob_c74fc1_spiralesurbaines.jpg)
/image%2F0995560%2F20150117%2Fob_94eedb_point-d-interrogation.gif)
/image%2F0995560%2F20150104%2Fob_233f4d_point-d-interrogation.gif)
/image%2F0995560%2F20141119%2Fob_4cd23f_grandperecover.jpg)
/image%2F0995560%2F20141119%2Fob_3ac624_annonciade.jpg)
/image%2F0995560%2F20150105%2Fob_c2f2ff_point-d-interrogation.gif)